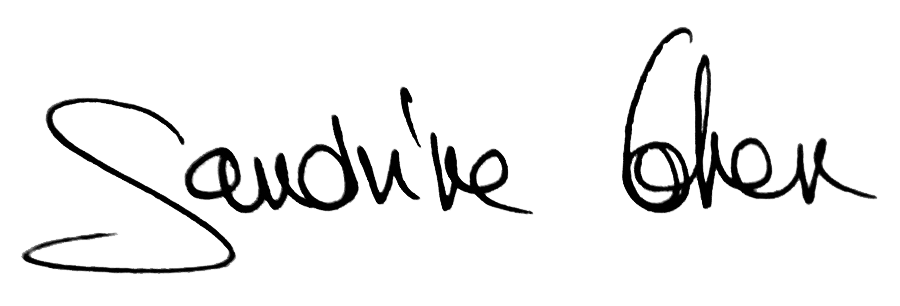Connexion

Une fin d’après-midi de novembre, je suis dans le train Paris – Lyon. Ça me rappelle il y a six ans. Six ans déjà, six ans maintenant, mon film, Le Goût du partage, Le Goût du partage, que j’ai tourné à Lyon. J’en ai fait des allers retours Paris – Lyon.
Là, je vais passer une soirée avec des médecins, des ophtalmologues, je vais parler de la relation aux patients, comment communiquer, comment communiquer au mieux, avec eux. Comment communiquer au mieux avec soi, avec l’autre, voilà un sujet qui m’habite. Parfois, encore, quand je suis trop fatiguée, quand je suis absente à moi-même, quand l’autre vient toucher sans le savoir, là où ça fait mal, ou bien là où ça fait bien, là où il me faut apprendre encore, je me laisse surprendre et les réflexes reviennent rapidement, les comportements refuges, l’attaque ou la fuite quand ce n’est pas la tétanie. La tétanie, je connais bien la tétanie, le pire, la mort quand elle ne se voit pas, l’effondrement intérieur. N’empêche, j’avance, j’explique, j’apprends, j’apprends à nouveau en expliquant. Je répète pour mieux entendre, ce que je fais déjà, ce que je ne fais pas assez, ce que je veux faire toujours, le plus souvent : oser être soi en laissant l’autre être autre. La communication, les mots, sont notre base de relation, à soi, à l’autre.
L’autre, c’est une grande affaire pour moi. J’aime l’autre autant que j’en ai peur. J’aime l’autre profondément. J’en ai peur tout autant, même si ça ne se voit pas, même si j’ai mis si longtemps à le comprendre parce que ma nature est curieuse, et aimante. Oui, j’aime l’autre et je le crains, je le sais maintenant même si, même en l’écrivant, ça me parait encore un peu abstrait. J’aime l’autre et je le crains, je l’aime plus que je ne le crains. La plupart du temps, je ne me laisse pas le temps de le craindre. J’accueille. Un jour, une femme a dit devant moi : « Sandrine, c’est comme une maison avec une porte ouverte, ceux qui veulent entrer sont les bienvenus et après, ils ont leur place. » C’est vrai. Je ne demande pas de droit d’entrée. Je ne demande pas de pedigree. J’accueille. Je pense aussi que je suis toujours si surprise qu’on m’apprécie que j’ouvre les bras, comme l’enfant qui câline qui veut bien de lui. Quand cet enfant a manqué d’amour. C’est comme ça. Oui, c’est comme ça et qui peut savoir si c’est un mal ou si c’est un bien. C’est comme ça, et, au fond de moi, une croyance : nous ne sommes rien sans l’autre. Le lien à l’autre, les rencontres, évidemment ça passe par le lien à soi mais quand même, l’autre, le lien à l’autre, échanger, partager, même la solitude, même et surtout le sens, de la vie, c’est tellement important. Mon film s’appelle Le Goût de partage et, au-delà d’un choix aussi de production, ce titre prend tout son sens.
Je pense à tout ça dans le train Paris-Lyon sans y penser vraiment. Je pense aux malades, aux patients, à l’importance de les mettre au cœur de la maladie, au cœur de la guérison. Le patient est une personne. Je pense à mes amis, essentiels, je pense à ma sœur et à mon neveu, ma famille, à ma fille. L’autre. Je pense à cette connexion, à ce qui nous relie, à l’autre, au monde, à nous-même. Oui, bien sûr, la connexion commence par soi mais tellement avec l’autre. Et, dans ce train Paris-Lyon, je suis prête à parler à mon voisin, ou à celui qui voudra ma place, sa place, allez savoir pourquoi, je ne m’assois quasiment jamais à ma place, un réflexe aussi sans doute. Je ne supporte pas le cadre, ni la contrainte. Elle a du bon pourtant aussi parfois, la contrainte. Je suis assise à côté d’un homme. Il est en train de travailler sur son ordinateur. Je pense à mes rencontres et à ma fidélité. Je ne demande pas de droit d’entrée mais quand tu entres, c’est pour la vie : je me sens responsable de ceux que j’ai apprivoisés. Le petit Prince regorge de vérité. Il a l’air sympa mon voisin, mais il est très occupé. J’écoute le « tac – tac », des touches de son clavier, ce son si percutant.
Je suis souvent connecté à mon ordinateur. Je ne travaille pas, j’écris et quand j’écris, c’est à moi que je suis connectée. Mon ordinateur, c’est ma maison, c’est ma vie. À la fin de mon film, j’ai fait une phobie. On me l’avait volé, je n’en voulais pas d’autres, mais je ne pouvais pas m’en passer, je ne peux pas me passer d’écrire. Et puis plus tard, quand j’en ai eu un autre, après, en avoir pris cinq ou six en essai, quand je me suis dit : « Tu gardes celui-ci et c’est tout, tu ne bouges plus. » ou plutôt quand ma psy me l’a dit, je ne voulais plus qu’on le touche. C’est comme ça, il fallait sans doute que je connecte avec la peur en moi, de l’autre. Mon ordinateur était moi et chaque main dessus était perçue comme une violence, faite à mon corps, faites à mon cœur. Il faut dire que j’en ai vécu des violences alors, c’est normal sans doute, cette peur de l’autre, en moi. Mais je ne la connaissais pas. J’ai encore du mal à la cerner.
Je sais que je suis une hypersensible. Ça n’empêche pas la clarté des sens. Au contraire, c’est juste que j’entends tout, surtout ce qui ne se dit pas et je sens tout, comme la princesse au petit pois. Il n’y a pas de filtre entre le monde et moi. C’est comme ça. Qui fait la poule et qui fait l’œuf, je ne sais pas. Je ne sais pas qui de la peur ou de l’hypersensibilité était là la première. Je crois que c’est l’hypersensibilité et que la peur l’a accentué : la vigilance a les sens exacerbée. En tout cas, là, je me dis que ce « tac – tac », je dois l’oublier sinon il va m’obséder comme le signe aussi, de quelqu’un à qui je ne peux pas parler. Le « tac – tac » du clavier comme l’entrave entre homme et moi. L’entrave aussi entre soi et soi. La connexion a l’ordinateur empêche la rêverie. C’est pareil pour le téléphone. Ah les smart phones, malins mais pas pratiques pour communiquer vraiment. Un texto, plusieurs, une conversation écrite abandonnée, sans un mot, sans un au revoir. Un message vocale envoyé, pas le temps de discuter, mais je t’envoie ma voix pour te dire que je pense à toi. Il semble parfois que tout est fait pour ne pas se parler. Pour zapper. C’est difficile de communiquer, avec soi, avec l’autre, de rester connectés. Ça fait peur, au fond. Au fond, je me demande si nous n’avons pas tous un peu peur de l’autre. Je ne serais pas la seule?
Je n’ai pas envie de sortir mon ordinateur, j’ai envie d’être là et de regarder le temps passer. J’ai envie de me rencontrer. Un homme approche, je suis assise à sa place, évidemment, cette manie de m’assoir là où il ne faut pas. Je laisse ma place de bonne grâce. Je tente une plaisanterie mais l’homme est déjà assis. Il ouvre son ordinateur, mets des écouteurs, je n’ai pas eu le temps de lui demander comment ça va la vie. Je regarde ces deux hommes assis, ils ne se sont pas dit bonjour, ils ne se sont pas salués, ils sont voisins mais ils ne vont pas se rencontrer. C’est comme ça. C’est comme ça et ça va durer. Je regarde mon billet. En plus, je me suis trompée de voiture. Je dois remonter, le train, le fil du temps, Paris – Lyon, il y a six ans. Je remonte le train et tout le monde est connecté. C’est incroyable, tout le monde, quasiment sans exception travaille sur son ordinateur. Et je me demande quand ça a commencé ? Ce n’était pas comme ça il y a six ans, je m’en souviens très bien. Mes comédiens plaisantaient avec leurs voisins. Je buvais une bière au bar, il y avait des gens que je ne connaissais pas, que je ne reverrais pas. J’avais mon ordinateur ouvert aussi parfois mais ouvert sur l’autre, le goût du partage. Je me souviens d’un petit garçon à qui j’ai montré mes photos de voyages. Mon ordinateur est allumé aussi à l’autre. C’est comme ça. J’ai la chance de pouvoir écrire et m’interrompre, parler. Je crois qu’au-delà de la peur, l’envie est pour moi toujours plus forte de rencontrer l’autre, le goût de l’autre. Et je remonte le train, et ceux qui ne sont pas sur leur ordinateur sont sur leur téléphone. Ils sont connectés et il n’y a plus de place à la connexion, ni à soi, ni à l’autre. Il n’y a de la place qu’au « tac – tac » assourdissant du clavier. Heureusement, la plupart des téléphones sont sur silencieux. Ça me fait mal au cœur soudain tout ce « tac – tac » d’insensibilité. Ça fait mal à la sensible que je suis. La machine a pris le pas sur l’humain. Il n’y a pas de livres, quelques journaux. C’est drôle mais les livres, les journaux, même s’ils sont des invitations à la solitude, ce n’est pas pareil. Ils sont une connexion à soi, à l’autre. On peut en parler. On parle du dernier livre que l’on a lu, de ceux qui nous ont marqué à jamais, du prochain dont on a envie. Les livres m’ont sauvé la vie et j’adore ces conversations d’allumés qui consiste à faire la liste des chefs d’œuvre de la littérature, de ces livres qui nous ont sauvé, le temps du livre, vraiment, de ceux qui inventent des mondes, de ceux qui inventent une nouvelle connexion entre le monde et nous. Les mots écrits ont ce pouvoir, quand ils sont écrits avec le cœur, qu’ils racontent une histoire ou une pensée. Personne n’a jamais vu une connexion internet être l’objet d’une discussion, ni un tableau Excel, ni même un j’aime sur Facebook même si j’aime Facebook et que ce réseau pas si social est un véritable objet de d’échanges. Je remonte la rame, et je suis suffoquée. Je ne croise pas un regard, pas un sourire, il est dix-huit heures, c’est une fin de journée, c’est une fin des temps, la fin de la discussion. Je suis connectée.
Ma voiture est la dernière, je m’assois à ma place, il faudra que je pense à le faire plus souvent, histoire d’être connectée avec moi et pas avec le passé, mon histoire passée. Je m’assois à côté d’un homme. Il est sur son clavier. Il lève à peine la tête. Tac. Tac. Le bruit du clavier. Bonjour. J’obtiens un vague bonjour en retour. Je m’assois, je sors mon journal, Télérama. Dans mon sac m’attend mon livre, je le sors aussi. Ce n’est pas un chef d’œuvre mais je voudrais parler du Lambeau de Philippe Lançon, magnifique témoignage de notre nouvelle modernité, rescapé de Charlie Hebdo, il a raconté son histoire, sur un clavier d’abord et puis sur du papier imprimé, connecté, cet homme est tellement connecté. N’importe quel livre aujourd’hui me ferait parler de celui-ci. Mais il ne sera question de rien, juste du « tac – tac » du clavier que je décide délibérément d’oublier. Il s’agit oui, parfois, de décider de dire à mon cerveau d’oublier. Sinon, je ne pourrais pas vivre. Je suis peut-être trop connectée.